
Huahine, légendes, vanille et biodiversité
Sur Huahine, les oiseaux servent de réveil. Ils sont très présents, surtout dans la forêt, et font un vacarme magnifique. Je rejoins mes hôtes sur la terrasse, Marc m’invite à le suivre dans le jardin.
par Thomas Risse · 01.06.2016
Je passe quelques jours à Pape’ete, Céline me fait visiter la ville : elle se résume à une longue rue avec des boutiques sur le front de mer et un grand marché couvert dans le centre. Le marché est un lieu qui grouille de vie dès 5h du matin, puis cela s’estompe au fur et à mesure que les étals se vident. Une fois sortis du marché et après avoir acheté du thon rouge et du lait de coco pour préparer le plat polynésien typique, nous allons visiter la cathédrale « Notre Dame de Pape’ete ».
Elle est très fréquentée, la plupart des tahitiens sont croyants et pratiquants. Tous les dimanches et les jours fériés, ils se lèvent tôt afin d’avoir les meilleures places pour le culte. On distingue un quart de catholiques et un peu plus de la moitié de protestants. Adventistes, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Communauté du Christ, Mormons et Témoins de Jéhovah se partagent le quart restant. Cependant, le monothéisme des polynésiens est assez jeune.
En effet, jusque vers 1800 environ, ils vénéraient de nombreuses divinités. Leur religion était basée sur des mythes qu’ils célébraient lors de grandes cérémonies organisées dans leurs lieux de culte : les marae. C’est l’arrivée des missionnaires anglais qui a bouleversé leur civilisation. Ils réussirent à convertir presque toute la population au protestantisme en se rapprochant de la famille régnante, les Pōmare. Leur plus grande réussite fut le « Code Pōmare » qu’ils incitèrent le roi à proclamer, interdisant toute les danses, les chants, les tatouages et les parures de fleurs. Le Code qualifiait toutes ces traditions d’impudiques, allant même jusqu’à obliger le port de vêtements couvrant tout le corps. Aujourd’hui, les polynésiens ravivent petit à petit leur culture d’antan dans le respect de la tradition, mais en ajoutant une touche moderne.
Après la visite de l’église, nous marchons dans la capitale tahitienne. On se rend vite compte que le centre est petit et qu’il est facile d’en sortir. A plusieurs reprises, nous débouchons sur des ruelles bordées de maisons familiales. En Polynésie, il y a un chien pour presque chaque foyer. En plus de cela, il y a les cabots qui n’appartiennent à personne et qui errent dans les rues. Lorsqu’ils sont seuls, ils ne posent pas de problème, la plupart du temps (je reviendrai là-dessus…). En meute, ils peuvent être agressifs et mieux vaut ne pas s’approcher.
Soudain, un détail me choque : alors que le centre et le front de mer étaient propres et entretenus, ces ruelles sont comme laissées à l’abandon et sales. Par endroit, des déchets en tout genre sont amassés sur plusieurs mètres, souvent juste au dessous de panneaux indiquant « interdiction formelle de déposer vos immondices sous peine de poursuites ». On m’expliquera plus tard que personne ne sévit, ce qui encourage les gens à continuer. Comme il n’y a pas vraiment de décharge, la rue fait l’affaire.
Un lait de coco acheté au bord de la route et je me rends dans l’agence Air Tahiti la plus proche pour acheter le précieux pass inter-iles. Je fais valider mon itinéraire par l’hôtesse et c’est dans la poche. Demain je prendrai le bateau pour Moorea, l’ile sœur de Tahiti, à la découverte de la fameuse baie de Cook…
A suivre

Sur Huahine, les oiseaux servent de réveil. Ils sont très présents, surtout dans la forêt, et font un vacarme magnifique. Je rejoins mes hôtes sur la terrasse, Marc m’invite à le suivre dans le jardin.
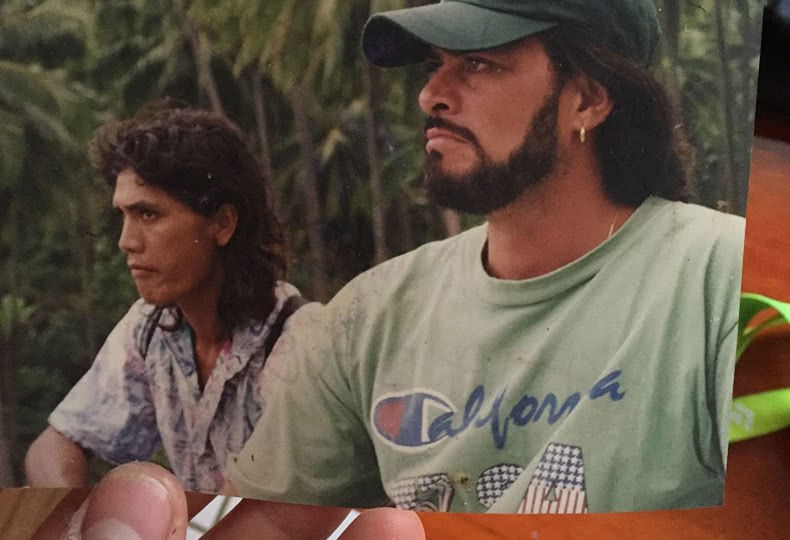
Les aéroports insulaires de Polynésie n’ont rien à voir avec ceux des capitales ailleurs dans le monde. Ils sont petits, très ouverts, dépourvus de portiques de sécurité, ils feraient frémir plus d’un Newyorkais.

Mon avion pour Bora décolle tôt ce matin. Je me lève donc de bonne heure, car l’aéroport est à l’autre bout de l’ile et je m’y rends en stop.